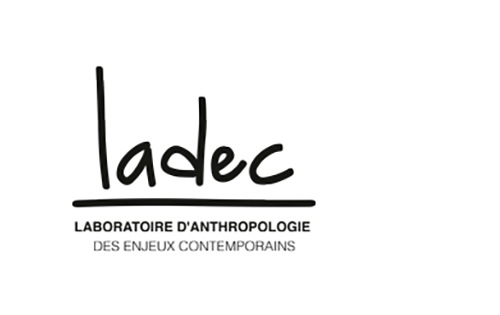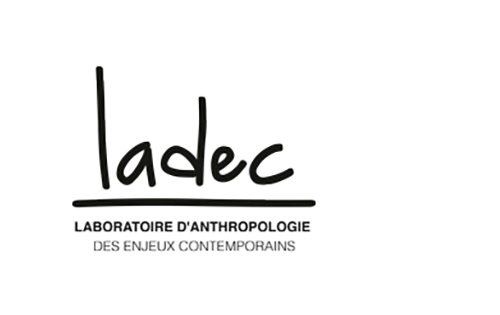Publié le 9 octobre 2025
–
Mis à jour le 4 novembre 2025
du 16
au 17 octobre 2025
au 17 octobre 2025
Hors les campus
Journées d’études et Atelier Écrire filmique
Écrire en image, cela, non seulement, s’apprend mais, bien plus important, dans un monde en mouvement, saisir le moment où le non-dit se voit est l’une des visées de la recherche en anthropologie. Ces invisibles peuvent se donner à saisir sur les visages, les gestes, les circulations et le mouvement des corps et des objets.
Dans cette perspective, les interventions de Marine Rougeon et Nicolas Jaoul permettront de revenir sur les deux échelles complémentaires du documentaire anthropologique: celle de la réalisation (observation, tournage, mise en image, narration, montage), et celle de la connaissance documentaire et anthropologique (qu’est-ce qu’une image documentaire ? En quoi est-ce qu’elle contribue à la connaissance anthropologique ? Que nous permet-elle de capter et de sentir ?). Ces journées seront également nourries de réflexions interactives entre les personnes participantes et les chercheurs & chercheuses.
- Historique de ces journées
-
Lors d’une première journée d’étude le 5 mai 2025, nous avons envisagé les enjeux de l’utilisation des images (photographie, film) dans la recherche et interrogé les questionnements éthiques relatifs à leurs usages. Lors de la présentation de Salomé Deboos, membre du Comité de Pilotage du Réseau Thématique EASI (Écritures alternatives, Sciences Sociales et Images), nous avons abordé plusieurs questions : est-on légitime à photographier les personnes avec qui nous travaillons et coconstruisons un savoir anthropologique ? Quelles places pour le chercheur dans ces dispositifs ? Quelles places pour l’image dans le discours scientifique ? Comment raconte-t-on une recherche ou un terrain en image ?
Puis, grâce à l’intervention d’Alice Aterianus-Owanga (Institut d'ethnologie, Université de Neuchâtel), nous avons dans un premier temps envisagé la manière dont le film ethnographique accompagne ou précède un questionnement scientifique : comment construire un projet de film ? Quelle est la place de l’écriture dans l’élaboration d’un projet ? Comment filmer ? Comment monter, sélectionner les rushs ? Comment utiliser / valoriser ceux-ci dans une production scientifique écrite ? Dans un second temps, un atelier a pris place tout l’après midi autour de l’écriture d’un pitch : Quelles en sont les clés, le tempo ? Comment transmettre l’idée et la visée générale d’un documentaire en créant du sensible qui puisse permettre à l’interlocuteur de saisir d’un seul regard la profondeur de la réflexion du réalisateur.
Suite à cette journée, les étudiants ont appelé de leurs vœux la mise en place de deux nouvelles journées autour de la pratique et de l’image.
Dans cette perspective, les interventions de Marine Rougeon et Nicolas Jaoul permettront de revenir sur les deux échelles complémentaires du documentaire anthropologique: celle de la réalisation (observation, tournage, mise en image, narration, montage), et celle de la connaissance documentaire et anthropologique (qu’est-ce qu’une image documentaire ? En quoi est-ce qu’elle contribue à la connaissance anthropologique ? Que nous permet-elle de capter et de sentir ?). Ces journées seront également nourries de réflexions interactives entre les personnes participantes et les chercheurs & chercheuses.
Au programme
- Jeudi 16 octobre 2025
-
10h-12h Atelier d’écriture documentaire Marina Rougeon, MCF anthropologie visuelle, UCly – UR Confluence Sciences et Humanités - EA1598)
Faire des images pour écrire le terrain : un engagement au monde et avec les autres.
Comment mettre en récit les expériences affectives et sensorielles que constitue le terrain ? Quelles modalités d’écriture privilégier ? Comment nos usages de divers médias graphiques (photographies, dessins) nous permettent de rendre compte de notre rapport au terrain, et de sa faculté de transformation, tant au niveau personnel (affectif), qu’en termes de construction de l’objet de recherche (réflexif) et de vision du monde (compréhensif) ? Voilà les questionnements qui guideront cette matinée. À partir d’éléments de terrain, il s’agira d’attirer l’attention sur la diversité des usages et des finalités de l’image en anthropologie. Elle peut être outil de production de connaissances sur le terrain, forme d’écriture à part entière, archive, ou encore médiation au moment de rapprocher les formes d’expression du chercheur ou de la chercheuse de celles de ses interlocuteurs et interlocutrices, y compris dans les approches de type participatives.12h-13h30 Pause déjeuner 13h30-16h Des cinéastes-ethnographes. Filmer le réel entre documentaire et fiction Pauline Guedj, MCF Anthropologie, LADEC, UFR ASSP – Université Lumière Lyon 2
Comment le cinéma de fiction ou le documentaire empruntent-ils à l’anthropologie et aux sciences sociales pour proposer une description précise des dynamiques sociales, culturelles et politiques qui affectent les mondes contemporains ? En s’intéressant à la filmographie de deux réalisateurs, Louis Malle et Steven Soderbergh, qui se sont à maintes reprises interroger sur les possibles reproductions au cinéma du « réel » et de sa « physicalité », nous réfléchirons ensemble aux relations entretenues entre cinéma, documentaire, fiction, approches ethnographique et anthropologique. - Vendredi 17 octobre 2025
-
10h12h De la thèse au film : un pas de coté heuristique Nicolas Jaoul, Chargé de Recherche CNRS, LIAC – UMR 8177
Sur la base du visionnage du film Sangarsh, il sera question d’envisager comment plusieurs années le chercheur réintérroge les données de terrain, notamment celles en image. Dans quelle mesure ce qui a été capté à une période permet de requestionner à la fois les mécanismes sociaux à l’œuvre sur le terrain et le positionnement des acteurs du terrain.
En partant de son expérience de terrain, Nicolas Jaoul reviendra sur les enjeux techniques, esthétiques et éthiques de la pratique filmique. Transdisciplinaire, cet atelier est ouvert à toutes les démarches et les formes audiovisuelles : film anthropologique, found footage, essai, documentaire sonore, etc. L’objectif est d’accompagner les étudiantes et étudiants dans leur projet et de nourrir une réflexion collective sur la diversité des écritures filmiques et leurs modalités singulières d’exploration et de connaissance du monde.
Pourquoi et comment faire un film ? Avec qui, quelles images et quels sons ? Comment aborder le sujet qu’on souhaite explorer avec une caméra ? Qu’est-ce que cela produit ? Comment filmer la parole, les corps, le mouvement et les émotions ? Comment organiser ses rushs et construire un cheminement ou une narration ? La fabrique d’un film engendre une multitude de hasards et de choix au moment du tournage et du montage qu’il s’agit de penser dans cet atelier, destiné aux étudiantes et étudiants souhaitant se familiariser avec les écritures audiovisuelles dans le cadre de leurs recherches.12h-13h30 Pause déjeuner 13h30-15h30 Session de clôture Salomé Deboos (PU anthropologie, LADEC, ULL2), Pauline Guedj (PU anthropologie, LADEC, ULLE)
Ce sera l’occasion de faire le point sur ces deux journées et d’envisager les besoins pour une prochaine session Atelier écriture filmique à Lyon.
Informations pratiques
Lieu(x)
Hors les campus
MSH Lyon – Saint Étienne,
Salle Berty Albrecht
16 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Salle Berty Albrecht
16 avenue Berthelot, 69007 Lyon
Partenaires
Responsables et contacts :
♦ Salomé DEBOOS, salome.deboos@univ-lyon2.fr
♦ Pauline GUEDJ, pauline.guedj7@univ-lyon2.fr
♦ Salomé DEBOOS, salome.deboos@univ-lyon2.fr
♦ Pauline GUEDJ, pauline.guedj7@univ-lyon2.fr

Documents à télécharger
Crédit photo
Salomé Deboos (2025)