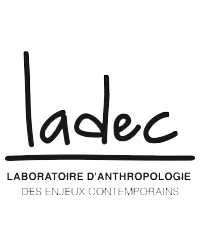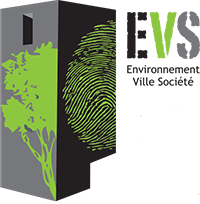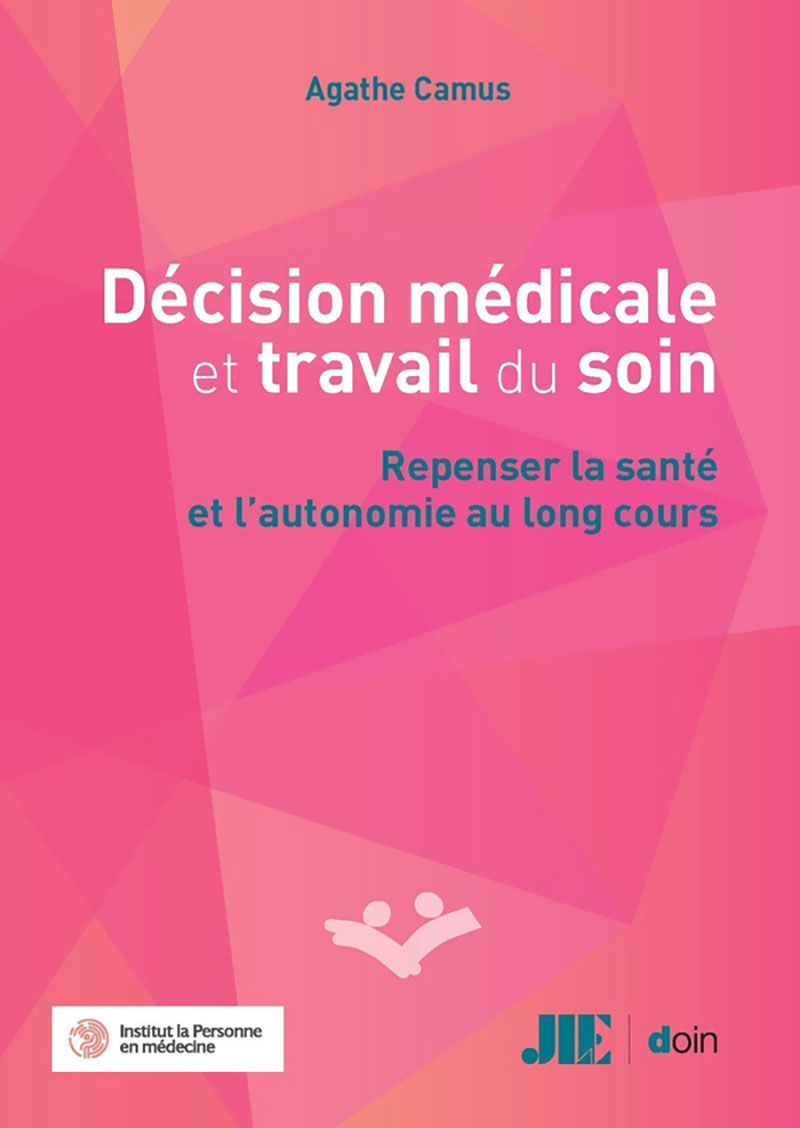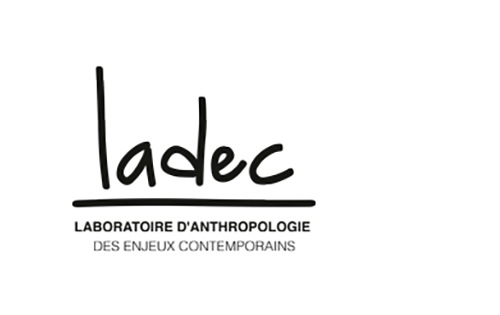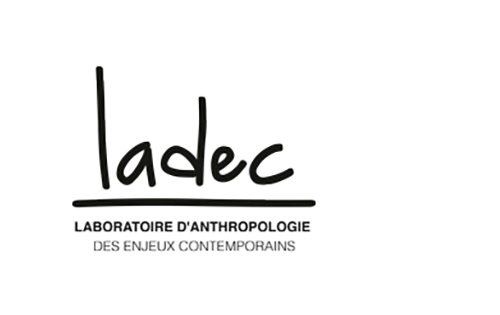Publié le 29 septembre 2025
–
Mis à jour le 30 septembre 2025
le 17 octobre 2025
Campus Porte des Alpes
de 10h30 à 13h
Séance du séminaire de recherche "Approches anthropologiques du care", porté par l'axe 2 "Les frontières des corps et du vivant" du Laboratoire d’Anthropologie des enjeux contemporains (LADEC)
Avec Agathe Camus, post-doctorante au laboratoire Sciences, Société, Historicité, Éducation et Pratiques (S2HEP / Université Claude Bernard Lyon 1). Dans le cadre de ses recherches, elle nterroge notamment les catégories de santé, d’autonomie, et de « vie normale », tant dans leur sens philosophique que dans leurs usages ordinaires ou encore médicaux, à la lumière de l’expérience de la maladie chronique, de la multimorbidité et du handicap.
Le séminaire est ouvert à toute personne intéressée par le sujet abordé (entrée libre).
| L’hémodialyse est une technologie de suppléance organique qui vise à remplacer la fonction des reins chez les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique terminale. C’est un traitement vital, qui s’avère particulièrement lourd et contraignant : plusieurs séances de dialyse par semaine, durant lesquelles les personnes restent « branchées » au générateur de dialyse entre 2,5 et 4h, selon les modalités de traitement. Le temps passé en dialyse est parfois décrit comme un « temps mort », un moment où les patient.es se perçoivent « comme un corps-objet n'ayant d'autre choix que de dépendre passivement de la machine » (Gratreau, Legallais et Guchet, 2021). La vie en dialyse est également décrite par les personnes comme fragmentée, ponctuée par des séances de dialyse qui perturbent les routines quotidiennes et empêchent un certain nombre d’activités. En termes d'espace, la dialyse implique en outre d'être confiné dans un lieu donné. Dans les centres de dialyse en particulier, l'organisation des soins et des lieux impose souvent une forme de passivité qui peut être difficile à supporter et qui fait obstacle à l’autonomisation des patient.es. Dans ce contexte, la dialyse à domicile est parfois présentée comme le « choix de l’autonomie ». Toutefois, les discours soignants, institutionnels et ceux des fabricants qui commercialisent les nouveaux générateurs d’hémodialyse à domicile véhiculent des conceptions parfois réductrices de l’autonomie, centrées sur la personne et ses capacités ou sur la technologie et ce qu’elle permet, sans considération pour les milieux dans lesquelles s’inscrivent les corps et les technologies. Or, la mise en place de la dialyse à domicile nécessite une « infrastructure de soin chronique » complexe (Langstrup, 2013), et elle est parfois décrite comme une redistribution des contraintes et des dépendances, dans des arrangements qui permettent plus ou moins de marge de manœuvre et de flexibilité, mais qui nécessitent d’être sans cesse réajustés - il faut sans cesse « réarranger les arrangements » (Lopez-Gomez, 2015) – autour de « ce qui compte » (ibid) pour les personnes malades. Dans cette présentation, qui s’appuie sur un travail de terrain exploratoire en centre de dialyse, je me demanderai dans quelles conditions le « soin technologique » (Lancelot & Guchet) qu’est l’hémodialyse peut se déployer comme un soin à part entière, et éventuellement, un soin de l’autonomie ? Je ferai également l’hypothèse que, pour prendre soin de l’autonomie des patient.es, il faut en outre réintégrer la question du choix dans une « logique du soin » (Mol, 2008) ? |
Informations pratiques
Lieu(x)
Campus Porte des Alpes
bâtiment H, 4e étage, salle H410.
Partenaires
Avec le soutien du laboratoire EVS et du LADEC
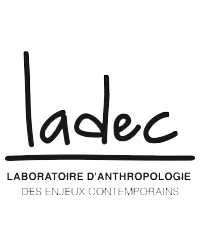
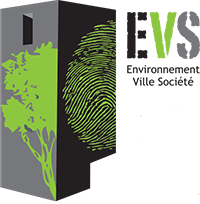
| Organisation : Julien Bondaz (LADEC), Bianca Botea (LADEC), Tofie Briscolini (EVS), Juliette Cleuziou (LADEC), Marie-Pierre Gibert (EVS), Axel Guïoux (EVS), Evelyne Lasserre (EVS / Université Claude Bernard Lyon 1) |